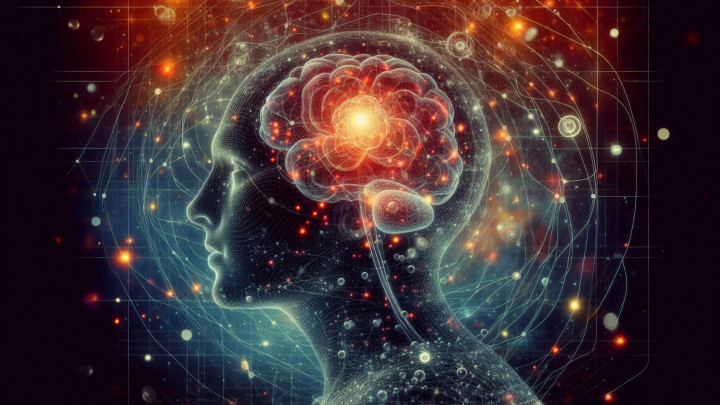Argent, pouvoir et société dans les longues vagues de l'histoire
Dans une analyse précédente, nous avons identifié les révolutions technologiques comme le moteur principal des longues vagues économiques, connues sous le nom de cycles de Kondratiev. La machine à vapeur, les chemins de fer, l'électricité et la micropuce furent toutes des innovations fondamentales qui ont remodelé l'économie mondiale selon des cycles récurrents de 50 à 60 ans. Cependant, cette vision centrée sur la technologie ne raconte qu'une partie de l'histoire — bien que spectaculaire. En coulisses, d'autres forces tout aussi puissantes sont à l'œuvre : le flux de capitaux financiers, les marées changeantes de l'humeur sociale et le réalignement du pouvoir mondial.
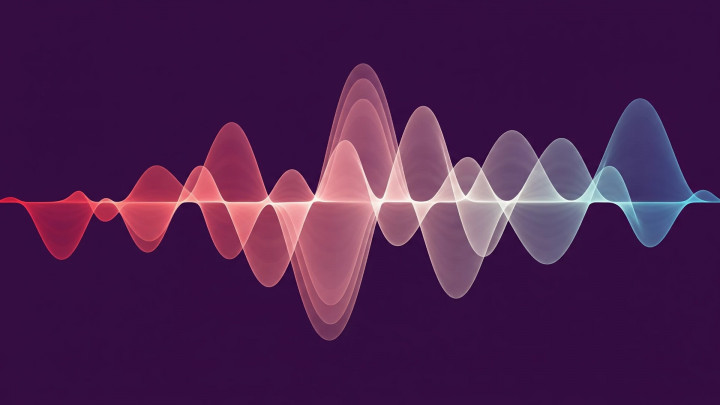
Cet article explore ces dimensions cachées des vagues de Kondratiev, examinant comment l'innovation technologique est inextricablement liée à la spéculation financière, comment les « saisons » économiques se reflètent dans notre politique et notre société, et comment chaque nouvelle vague peut redessiner la carte géopolitique mondiale.
La double danse du capital financier : création et destruction
Une révolution technologique ne se produit pas en vase clos. Pour qu'une invention prometteuse devienne une force capable de transformer l'économie entière, elle nécessite une injection massive de capitaux. C'est là que le capitalisme financier entre en jeu, un rôle décrit de manière très éloquente par l'économiste néo-schumpétérienne Carlota Perez. Dans son modèle, chaque longue vague est divisée en deux périodes principales : la Phase d'Installation et la Phase de Déploiement, séparées par un Point de Bascule critique – généralement un krach financier majeur.
- La Phase d'Installation : Lorsqu'un nouveau paradigme technologique émerge (comme Internet dans les années 1990), le capital financier — l'argent spéculatif en quête de rendements rapides et élevés — s'engouffre. C'est le « printemps » et l'« été » du cycle : une sorte de ruée vers l'or où les investisseurs injectent des fonds de manière imprudente dans des startups liées à la nouvelle technologie, souvent sans grand souci des modèles économiques stables ou des revenus réels. Nous l'avons observé lors de la bulle Internet de la fin des années 1990. L'optimisme est palpable, mais cette phase marque aussi le début de la « destruction créatrice », car la nouvelle technologie commence à menacer les anciennes industries. Inévitablement, cette frénésie de spéculation conduit à une bulle.
- Le Point de Bascule : Finalement, la bulle éclate. Le krach boursier de 2000 et la crise financière de 2008, encore plus importante, sont des exemples parfaits de ce point de bascule. Ces crises sont incroyablement douloureuses, mais selon Perez, elles sont aussi nécessaires. Elles purgent le marché des entreprises non viables et imposent une « réalité » aux investisseurs. Le krach agit comme un creuset, forgeant une technologie plus mature, prête pour une application pratique et généralisée.
- La Phase de Déploiement : Après la crise, l'accent passe de la spéculation à la production. Le capital de production (l'argent investi dans les usines, les infrastructures et les produits réels) prend le relais. La technologie n'est plus seulement une promesse ; elle est intégrée au cœur de l'économie. C'est à ce moment que les grandes entreprises stables sont bâties (à notre époque, pensez à Google, Amazon et Apple), et que les avantages de la technologie commencent à se répandre dans des segments plus larges de la société. Cette phase représente la « fin de l'été » et l'« automne » du cycle — un « âge d'or » de prospérité et de stabilité qui mène finalement à la saturation du marché et au ralentissement de la croissance, préparant le terrain pour le prochain « hiver ».
Ce modèle explique pourquoi les grandes avancées technologiques sont si souvent inséparables des bulles financières apparemment irrationnelles et des krachs dévastateurs qui s'ensuivent.
Un miroir de la société : saisons économiques et tempêtes politiques
Les vagues de Kondratiev ne se contentent pas de laisser leur empreinte sur les graphiques économiques ; elles influencent profondément l'humeur sociale et les dynamiques politiques. Les « saisons » économiques se reflètent presque parfaitement dans la psyché collective.
- Printemps et Été : Les premières étapes du cycle sont caractérisées par un optimisme social. Il y a une croyance généralisée dans le progrès, et la mobilité sociale — le rêve de passer de la pauvreté à la richesse — semble une possibilité tangible. Une économie en croissance renforce la classe moyenne, ce qui favorise généralement la stabilité politique. Les débats ont tendance à porter sur la manière de distribuer le gâteau qui s'agrandit, et non sur la remise en question des fondements du système lui-même. Pensez aux décennies d'après-guerre dans le monde occidental.
- Automne et Hiver : À mesure que le cycle mûrit et entre dans ses dernières étapes, la croissance ralentit, les marchés se saturent et les marges bénéficiaires diminuent. Les entreprises se concentrent sur la réduction des coûts et l'efficacité, ce qui entraîne souvent des pertes d'emplois et une stagnation des salaires. Parallèlement, les rendements du capital dépassent souvent la croissance économique, entraînant une augmentation spectaculaire des inégalités sociales. Les gens commencent à sentir que le « jeu est truqué » et que le contrat social a été rompu. Cela engendre une ère de pessimisme, de méfiance et de colère, offrant un terrain fertile aux mouvements populistes, à la polarisation politique et aux défis radicaux au statu quo. Les tensions politiques actuelles, le rejet de la mondialisation et l'érosion de la confiance dans les institutions démocratiques à travers l'Occident ne sont pas des événements aléatoires ; ce sont des symptômes classiques d'un hiver de Kondratiev.
Les marées de l'hégémonie : changements géopolitiques
L'impact des vagues de Kondratiev se fait également sentir sur la scène internationale. Historiquement, la nation qui maîtrise et déploie le plus efficacement la technologie d'une nouvelle vague accède souvent à une position d'hégémonie mondiale. Le nouveau paradigme technologique confère non seulement une domination économique, mais aussi une suprématie militaire et culturelle.
- Les première et deuxième vagues (vapeur, chemin de fer) ont coïncidé avec l'ascension de la Grande-Bretagne. Ses usines, sa marine et son réseau commercial mondial en ont fait la puissance dominante incontestée du XIXe siècle.
- Les troisième, quatrième et cinquième vagues (électricité, pétrole, automobile, technologies de l'information) ont marqué l'avènement de la domination des États-Unis. La production de masse américaine, l'innovation technologique (Silicon Valley) et la puissance financière (Wall Street) ont fait du XXe siècle le « siècle américain ».
Cela soulève l'une des questions géopolitiques les plus critiques de notre époque : qui mènera la sixième vague ? Bien que la prévision soit une entreprise risquée, les signes indiquent clairement une nouvelle compétition pour le leadership technologique.
- La Chine mène une offensive délibérée, financée par l'État, pour dominer les technologies clés de la sixième vague, notamment l'intelligence artificielle, l'énergie verte et la biotechnologie. L'ambition de Pékin n'est rien de moins que de briser l'hégémonie technologique américaine.
- Cependant, les États-Unis possèdent toujours une capacité d'innovation extraordinaire et restent à la pointe de nombreuses technologies fondamentales. L'issue de cette compétition est loin d'être décidée.
Certains analystes suggèrent avec prudence que la sixième vague pourrait ne pas produire un seul hégémon, mais plutôt favoriser un ordre mondial multipolaire, avec de multiples centres de pouvoir technologique et économique en compétition et en collaboration. Ce réalignement géopolitique sera probablement l'une des histoires marquantes du XXIe siècle.
En conclusion
Comprendre les vagues de Kondratiev nous emmène au-delà d'une simple analyse de la technologie et de l'économie. Cela offre une lentille puissante pour observer les tensions sociales les plus profondes et les changements géopolitiques de notre époque. L'euphorie et la panique des marchés financiers, la montée de la polarisation politique et la compétition entre grandes puissances ne sont pas des événements isolés, mais des éléments d'un schéma cyclique plus vaste. L'incertitude et les troubles de notre « hiver » actuel pourraient bien être les inévitables douleurs de croissance d'une nouvelle ère techno-économique. Reconnaître ce schéma ne fournit pas de réponses faciles, mais cela nous aide à poser les bonnes questions alors que nous nous tenons au seuil de la prochaine grande vague de l'histoire.